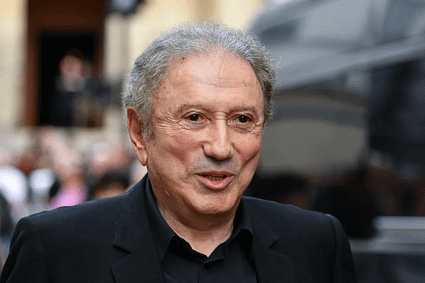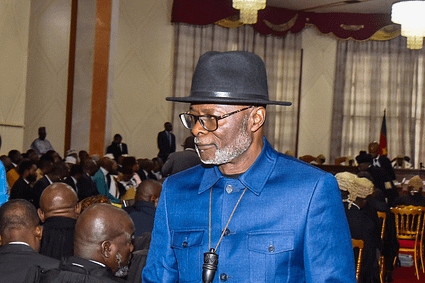Avec Jean Pierre BEKOLO
Alors que nous pataugeons encore dans une élection volée — confisquée par Paul Biya à Issa Tchiroma Bakary —, alors que ce dernier, en exil, serait engagé dans des tractations diplomatiques au nom du droit international et annonce son retour prochain, alors que Paul Biya, dans son discours de fin d’année, annonce la formation d’un gouvernement qu’on attends toujours et qu’on le voit, chez lui, croulant sous les dossiers dans son appartement privé chaotique, entouré de sa famille…
Alors que les Lions Indomptables se qualifient pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique qui se joue au Maroc unifiant les Camerounais divisés par le tribalisme,
alors qu’avec tout ceci les Camerounais tentent encore de définir ce qu’est un pays — ou plutôt font l’effort d’imaginer le Cameroun comme un pays libre et démocratique —, l’homme qui a un jour qualifié nos pays de « shithole countries », c’est-à-dire de pays de merde, décide unilatéralement d’envoyer son armée bombarder le Venezuela et de capturer son président et sa femme.
Tout en s’assurant que ses services lui fournissent une diffusion en direct de l’opération, qu’il peut suivre comme un reality show sur Netflix, pop-corn à la main. Une fois le film terminé, il s’empresse d’annoncer à la planète entière le succès de son opération, avec en toile de fond l’idée de « gérer » le pays.
Alors que certains crient déjà au braquage en mondovision du pétrole vénézuélien, il ne fait aucun doute, pour nous qui faisons partie des plus faibles, qu’un monde régi par la loi du plus fort est un monde où nous serons toujours perdants.
L’intervention de Trump au Venezuela a donc quelque chose de profondément décourageant, même si une part des Camerounais affaiblis par l’usage excessive de la force du régime de Paul Biya seraient tentés de lui dire :
« Viens aussi chercher Paul Biya et sa femme. »
Car nous sommes un pays où il y a trop de faibles pour que la loi du plus fort soit acceptable.
Un pays où la justice devrait exister précisément pour protéger ceux qui n’ont ni armes, ni argent, ni réseaux.
Si Trump s’est permis de nous humilier — et continue de le faire — en décidant qui a le bon passeport pour entrer aux États-Unis, et en affirmant que nous venons de « shithole countries », c’est aussi parce que nous n’avons pas encore réussi à bâtir des États dignes de ce nom.
Les refus de visas nous rappellent chaque jour que nos États ne sont pas démocratiques, qu’ils sont corrompus, mal gouvernés, et surtout pauvres.
Lorsqu’il établit — explicitement ou implicitement — la liste des pays dont les citoyens peuvent entrer librement aux États-Unis et de ceux qui doivent supplier, attendre, prouver, être refusés, Trump ne gère pas une politique migratoire.
Il fabrique une hiérarchie morale entre les pays — et donc entre les êtres humains.
Ainsi, au moment même où nous luttons pour faire advenir un pays digne de ce nom, où nous cherchons, non sans difficulté, notre voie, l’intervention de Trump au Venezuela vient en réalité nous décourager profondément.
Car pour nous, les faibles, elle confirme une vérité glaçante : le plus fort aura toujours raison.
Elle nous dit que le droit international n’est qu’un décor, que la souveraineté n’existe que tant qu’elle ne contrarie pas les intérêts des puissants, que nos richesses peuvent être arrachées par la force militaire sans autre justification que la capacité de le faire.
Elle nous montre comment les puissants occidentaux peuvent voler à ciel ouvert tout en mobilisant des valeurs morales dans les médias — la lutte contre la drogue, la démocratie, la sécurité — pour donner à la violence l’apparence de la vertu.
Tout le monde sait que c’est un mensonge.
Et pourtant, le mensonge fonctionne.
Parce qu’il est armé.
Le plus terrible, c’est le silence des autres dirigeants du monde.
Ils se taisent non par conviction, mais par peur.
Peur de fâcher le plus fort.
Peur que sa colère ne se retourne contre eux demain.
C’est un message dévastateur.
Si le monde n’est pas gouverné par des valeurs mais par des rapports de force, comment des pays comme les nôtres pourraient-ils exister ?
Et c’est là que la honte change de nature.
Ce n’est plus seulement la honte de nos échecs internes.
C’est la honte d’appartenir à un camp de pays qui n’ont ni le pouvoir de protéger leurs peuples, ni même le droit de se tromper sans être punis.
Nous voulions croire qu’un autre monde était possible.
Un monde où le droit limiterait la force.
Un monde où les faibles compteraient aussi.
Mais ce qui nous est montré, encore une fois, c’est que tant que nous resterons faibles, nos rêves de démocratie seront jugés naïfs, nos ressources considérées comme disponibles, et nos vies comme négociables.
Et c’est peut-être là le piège ultime :
on nous humilie pour ne pas avoir construit des États forts, puis on utilise cette faiblesse pour justifier qu’on nous écrase.
Une question demeure alors, incontournable :
comment construire des pays justes dans un monde qui récompense la force brute ?
Comment rester fidèles à l’idée de justice quand l’injustice armée gagne toujours ?
La seule réponse possible est de travailler à être forts là où les plus forts sont faibles :
dans la dénonciation de la violence, de l’indifférence, de l’injustice, du mensonge, du pillage.
Renonçons à la tentation du sauveur extérieur.
Renonçons à chercher un maître plus fort que nos maîtres.
Cela ne nous libérera pas du régime de la honte.
Là où l’on vivait autrefois — au moins en discours — dans l’idéal d’un monde cherchant à aider les peuples à sortir de la honte (misère, guerre, dictature), nous sommes entrés dans une ère nouvelle.
Aujourd’hui, un certain monde occidental — dont Trump n’est qu’une version décomplexée, brutale et assumée — ne cherche plus à réduire la honte. Il la fabrique. Il l’organise. Il la hiérarchise. Et il en tire profit en organisant ainsi un « désir de l’occident ».
Ce qui est décisif, ce n’est pas seulement cette production politique de la honte. C’est notre attitude, à nous, Africains.
Comment allons-nous gérer ce mécanisme central du monde contemporain : la production systématique de la honte ?
Le capitalisme joue ici un rôle central. Il ne cherche pas à réduire la honte. Il la fabrique. Il expose. Il compare. Il montre ce que vous n’avez pas.
Il n’a pas seulement produit des inégalités. Il a même produit la honte d’être pauvre.
Aujourd’hui, être pauvre, ce n’est pas seulement manquer. C’est voir en permanence ce que l’on ne peut pas avoir. Comparer. Se sentir en défaut.
La question est donc simple :
comment sortir d’un monde qui a besoin de notre honte pour fonctionner ? Comment refaire du pays un lieu de protection, et non de fuite ?
Un lieu de fierté, et non de justification permanente ? Parce qu’un pays humilié est d’abord un pays mal imaginé, mal raconté, mal gouverné, mal développé.
Le jour où nous déciderons de produire chez nous des formes de vie, des récits, des économies où vivre n’est plus une pénalité, personne ne trouvera chez nous un président et sa femme à capturer.